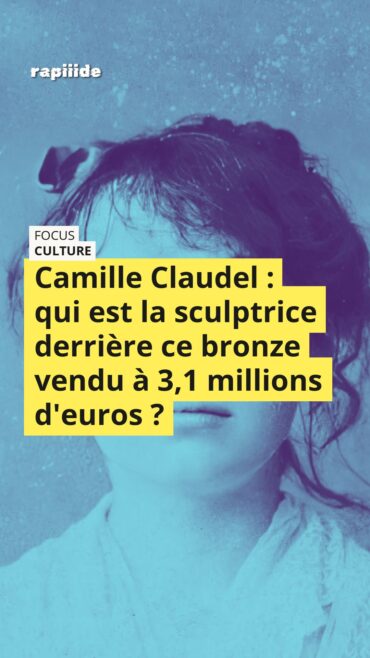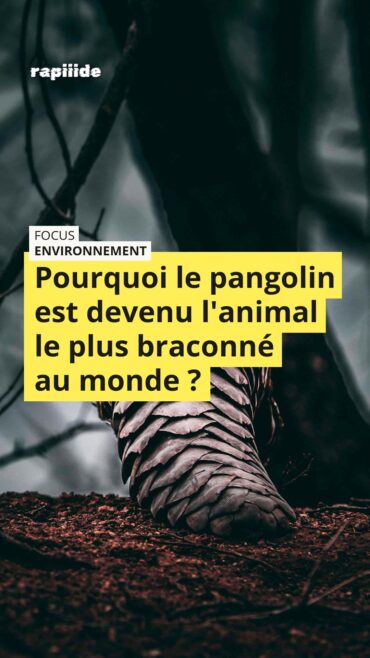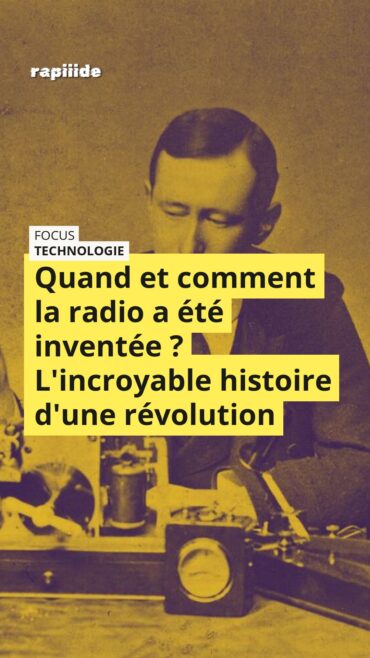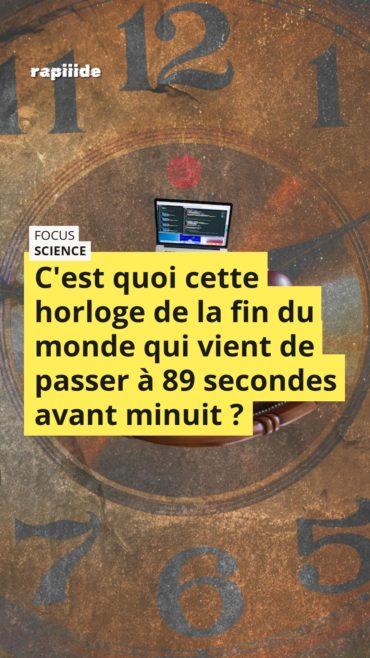Le virus de Marburg, connu comme l’un des agents pathogènes les plus redoutables au monde, fait parler de lui après une nouvelle épidémie dans la région de Kagera, au nord-ouest de la Tanzanie. À ce jour, huit morts ont été signalés sur neuf cas suspects. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme, craignant une potentielle propagation régionale, notamment vers des pays voisins comme le Rwanda ou l’Ouganda.
Origine et transmission
Découvert en 1967, le virus de Marburg a été identifié pour la première fois lors d’une contamination accidentelle liée à des singes importés en Allemagne. Son hôte naturel, la roussette d’Égypte, une chauve-souris, transmet le virus aux humains par contact avec des fluides corporels ou tissus infectés. Une fois transmis, les interactions humaines comme les soins aux malades ou les rites funéraires peuvent amplifier la propagation.
Des symptômes fulgurants
Le virus, après une incubation de 2 à 21 jours, provoque l’apparition brutale de fièvres élevées, de maux de tête intenses et de troubles digestifs. Les complications incluent des hémorragies internes et externes, avec une issue souvent fatale en moins de dix jours dans les cas graves.
Prévention et enjeux actuels
Actuellement, aucun traitement ni vaccin n’est approuvé. Les efforts de prévention reposent sur l’hygiène stricte et l’isolement des cas suspects. L’OMS reste mobilisée en Tanzanie, où la recherche des contacts et la sensibilisation des communautés locales s’intensifient.
Cette flambée en Tanzanie rappelle la menace latente que représente le virus de Marburg et l’urgence de développer des solutions médicales pour endiguer ce fléau mondial.
Les deux appartiennent à la même famille des Filoviridae, mais diffèrent légèrement dans leur structure génétique. Leurs symptômes et modes de transmission sont semblables.
Oui, certains patients survivent. Un traitement médical rapide et des soins intensifs augmentent les chances de survie, bien que le virus ait un taux de mortalité très élevé.
Non, aucun vaccin ni traitement spécifique n’est encore approuvé. La prise en charge est symptomatique, incluant la réhydratation et le contrôle des complications.
L’OMS envoie des experts pour renforcer la surveillance, identifier les contacts des malades, fournir des équipements et sensibiliser les communautés locales.
Évitez tout contact avec des animaux infectés ou leurs excréments, portez des équipements de protection et respectez strictement les mesures d’hygiène lors des soins.
Non, le virus de Marburg ne se transmet pas par l’air. La transmission se fait uniquement par contact direct avec des liquides biologiques contaminés ou des surfaces infectées.
Elles restent rares, mais le virus est présent dans certaines régions d’Afrique où son hôte naturel, la roussette d’Égypte, est endémique. Les flambées sont imprévisibles.
Les soignants, les membres de la famille des malades et les personnes manipulant des animaux ou des cadavres infectés sont les plus exposés. Une vigilance accrue est essentielle.